 L’art de Pierre Soulages est presque une définition de l’art, quelque chose qui nous dépasse et qui nous fait connaître en même temps une expérience de présence au monde parmi les plus fortes, en nous rapprochant du réel, du tangible, de l’humain et de l’infiniment beau.
L’art de Pierre Soulages est presque une définition de l’art, quelque chose qui nous dépasse et qui nous fait connaître en même temps une expérience de présence au monde parmi les plus fortes, en nous rapprochant du réel, du tangible, de l’humain et de l’infiniment beau.
Son art réunit la sophistication la plus extrême, la simplicité la plus désarmante, la matérialité la plus palpable et les jeux d’optique les plus troublants. Il utilise le noir le plus prégnant pour mieux convoquer la lumière. Il impose une énergique volonté en privilégiant des dimensions monumentales et en choisissant lui-même la façon d’installer ses œuvres. Mais il donne tout le loisir au spectateur d’y tourner autour pour les voir sous de multiples perspectives, de laisser son imagination vagabonder au delà des motifs, des lignes, de l’obsessionnelle non-figuration. Peintre de l’abstraction totale, il est tout autant celui de la matière, goudron sur verre, brou de noix, papier, peinture épaisse, toile.
La rétrospective que le Centre Georges Pompidou consacre à ce jeune nonagénaire, très réussie dans ses choix et dans sa scénographie, permet d’embrasser en mêmes temps et lieu l’ensemble du parcours du peintre Ruthénois. L’on y voit que tout se tient, qu’une étape de son travail en annonce une autre, que les "ruptures", même la révolution de l‘outrenoir n’en sont pas, mais la conséquence logique d’un cheminement cohérent. Telles apparaissent ainsi ses recherches sur la lumière, tantôt en choisissant le verre pour support, tantôt à travers le blanc de la toile strié de noir où la lumière semble passer comme par les interstices d’un volet, ou encore celle qui court sur les effets de peinture, où l’alternance des mats et des brillants créent autant d’effets différents.
Rétrospectivement, on comprend mieux pourquoi il a réalisé les vitraux en verre translucide blanc (une idée de génie) de la splendide abbatiale romane de Sainte-Foy de Conques dans l’Aveyron.
D’ailleurs, au sujet de ses fameux noirs et outrenoirs, ne dit-il pas : "Les gens croient que c’est du noir parce qu’ils ont du noir dans leur tête, en réalité, il s’agit de reflets sur les états de surface de la couleur noire."
Car il est très agréable aussi, au fil de l’exposition, de lire les belles phrases de Pierre Soulages, comme : "La réalité d’une œuvre, c’est le triple rapport qui s’établit entre la chose qu’elle est, le peintre qui l’a produite et celui qui la regarde"
Ou encore : "Ce qui importe au premier chef, c’est la réalité de la toile peinte : la couleur, la forme, la matière, d’où naissent la lumière et l’espace, et le rêve qu’elle porte". On ne saurait mieux dire.
Soulages
Centre Georges Pompidou – Paris IV°
M° Rambuteau
Jusqu’au 8 mars 2010
TLJ sf le mardi, de 11 h à 21 h
Entrée 12 € (TR 9 €)
Image : Soulages © Centre Pompidou
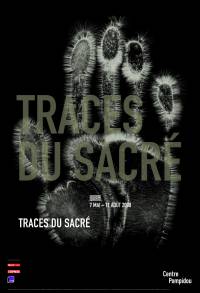 Que faire lorsqu’après avoir passé 2 heures dans une exposition présentée comme réunissant des oeuvres exceptionnelles autour d’un thème inédit, vous en ressortez au bord de la nausée, avec le sentiment de n’avoir rien vu de beau et une idée de son propos aussi vague qu’avant d’y entrer ?
Que faire lorsqu’après avoir passé 2 heures dans une exposition présentée comme réunissant des oeuvres exceptionnelles autour d’un thème inédit, vous en ressortez au bord de la nausée, avec le sentiment de n’avoir rien vu de beau et une idée de son propos aussi vague qu’avant d’y entrer ? Avec Joan Miró, qui dispose de son labyrinthe paysager constitué de statues et de céramiques exposées au milieu des pins, Alberto Giacometti est l’une des stars de la Fondation Maeght à Saint-Paul.
Avec Joan Miró, qui dispose de son labyrinthe paysager constitué de statues et de céramiques exposées au milieu des pins, Alberto Giacometti est l’une des stars de la Fondation Maeght à Saint-Paul. Le Musée National du Moyen-Age fait partie des quatorze musées et monuments nationaux français pour lesquels la gratuité est expérimentée depuis le début de l’année et jusqu’au 30 juin prochain. (1)
Le Musée National du Moyen-Age fait partie des quatorze musées et monuments nationaux français pour lesquels la gratuité est expérimentée depuis le début de l’année et jusqu’au 30 juin prochain. (1) Il faut absolument aller voir cette exposition mise en place au Centre Georges Pompidou jusqu’au 11 février 2008 (de préférence le soir en semaine pour des questions de fréquentation), dont on peut dire d’emblée que la scénographie est à la hauteur du programme : magnifique de clarté d’espace et de lumière. Et son parcours laisse une large liberté au visiteur.
Il faut absolument aller voir cette exposition mise en place au Centre Georges Pompidou jusqu’au 11 février 2008 (de préférence le soir en semaine pour des questions de fréquentation), dont on peut dire d’emblée que la scénographie est à la hauteur du programme : magnifique de clarté d’espace et de lumière. Et son parcours laisse une large liberté au visiteur. Harmonie, beauté, cohérence : malgré la diversité des inspirations nettement visibles ici ou là dans les oeuvres du catalan Julio Gonzales (1876-1942), l’exposition qui se tient jusqu’au 8 octobre au Centre Georges Pompidou imprime le sentiment d’une homogénéité certaine.
Harmonie, beauté, cohérence : malgré la diversité des inspirations nettement visibles ici ou là dans les oeuvres du catalan Julio Gonzales (1876-1942), l’exposition qui se tient jusqu’au 8 octobre au Centre Georges Pompidou imprime le sentiment d’une homogénéité certaine. Arshile Gorky (1904-1948), peintre américain d’origine arménienne demeure assez peu connu en Europe.
Arshile Gorky (1904-1948), peintre américain d’origine arménienne demeure assez peu connu en Europe.