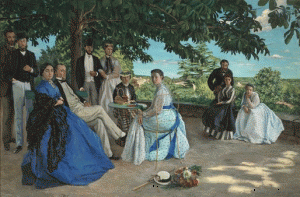Comment évoquer ce monde grec antique, dans lequel chacun et chacune vivait dans la proximité des dieux, de la manière la plus sensible pour le spectateur d’aujourd’hui ? Tout simplement en faisant appel, aussi, aux autres sens que la vue. L’exposition offre au visiteur l’occasion d’exercer son oreille aux sons de l’époque, de toucher les matières utilisées alors, de flairer les parfums et liquides privilégiés lors des rituels, éventuellement de goûter quelque mets favoris.
Comment évoquer ce monde grec antique, dans lequel chacun et chacune vivait dans la proximité des dieux, de la manière la plus sensible pour le spectateur d’aujourd’hui ? Tout simplement en faisant appel, aussi, aux autres sens que la vue. L’exposition offre au visiteur l’occasion d’exercer son oreille aux sons de l’époque, de toucher les matières utilisées alors, de flairer les parfums et liquides privilégiés lors des rituels, éventuellement de goûter quelque mets favoris.
La présentation se fait selon un parcours des moments les plus importants de la vie des Grecs, moments qui sont strictement ritualisés, parce qu’il était essentiel de se concilier la participation la plus favorable des dieux aux étapes marquantes de son existence, et plus généralement de ne pas se faire oublier d’eux.
Ainsi un grand tournant de la vie est le mariage : si nous pouvons découvrir sur les vases les peintures représentant des scènes des cérémonies, si de beaux objets de parure sont exposés dans les vitrines, nous pouvons aussi, casques sur les oreilles, écouter les musiques interprétées, entendre les textes dits. Dans des coupelles ont été préparées les mixtures qui servaient de cosmétiques, que nous pouvons sentir, et apprécier les textures et les couleurs.
Les sacrifices animaux en l’honneur des divinités étaient, comme les banquets, le moyen de se rapprocher des dieux afin de communiquer et de partager avec eux. On voit comment la victime (porc, chèvre…) était bien préparée, bien ornée, de guirlandes en particulier, avant le geste sanglant sur l’autel. Assez raisonnables finalement, les convives humains consommaient la viande bouillie ou rôtie et réservaient les viscères à leurs invités divins. Le public d’aujourd’hui peut humer le vin au calament ou l’huile aromatique au laurier, et même le parfum du cochon rôti.
 Avant le rôti, le Grecs pouvaient commencer par des amuses bouches bien aromatisés : olives, pois chiches, mûres de mûrier, figues, pignons. La musique accompagne chacun de ces rites et nous pouvons entendre le son de l’aulos en observant l’instrument lui-même, tuyau en os ou bois de roseau percé de trous. Les funérailles avaient leurs propres chants et leurs prières, et pendant l’exposition du cadavre et les processions les agents purificateurs faisaient leur office, qu’ils soient minéraux (souffre, sel) ou végétaux (verveine officinale, potentille).
Avant le rôti, le Grecs pouvaient commencer par des amuses bouches bien aromatisés : olives, pois chiches, mûres de mûrier, figues, pignons. La musique accompagne chacun de ces rites et nous pouvons entendre le son de l’aulos en observant l’instrument lui-même, tuyau en os ou bois de roseau percé de trous. Les funérailles avaient leurs propres chants et leurs prières, et pendant l’exposition du cadavre et les processions les agents purificateurs faisaient leur office, qu’ils soient minéraux (souffre, sel) ou végétaux (verveine officinale, potentille).
Si l’on ne devient pas totalement un Grec ancien au sortir de l’exposition, on mesure bien qu’une société s’imagine mieux selon une approche de tous les sens.
Andreossi
Rituels Grecs. Une expérience sensible
Musée Saint Raymond, Toulouse
Toutes informations sur le site du Musée
Jusqu’au 25 mars 2018


 C’est dans la tête de Sigismond Pons que se passe presque toute l’action de ce roman prix Goncourt 1967. Sigismond déambule dans le quartier « des putes » de Barcelone, durant quarante huit heures, a une relation avec l’une d’entre elles, entre dans les bars, restaurants, lieux de prostitution, qu’il nous décrit avec beaucoup de détails.
C’est dans la tête de Sigismond Pons que se passe presque toute l’action de ce roman prix Goncourt 1967. Sigismond déambule dans le quartier « des putes » de Barcelone, durant quarante huit heures, a une relation avec l’une d’entre elles, entre dans les bars, restaurants, lieux de prostitution, qu’il nous décrit avec beaucoup de détails.